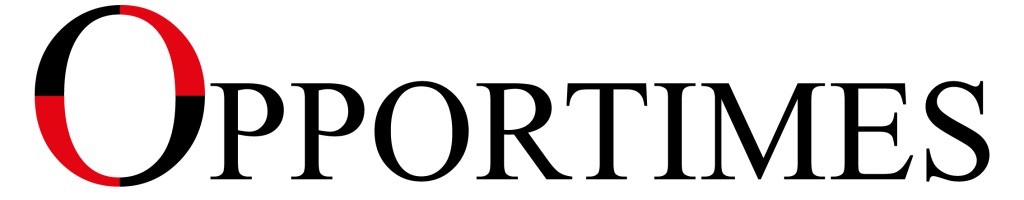Ricardo Santin, président de l’Association brésilienne des protéines animales (ABPA), a souligné la faible probabilité de transmission du virus H5N1 par la viande importée.
Également président de l’International Poultry Council, M. Santin a diffusé une analyse critique de ce risque sanitaire et de ses implications économiques mondiales.
Le virus H5N1 de la grippe aviaire hautement pathogène (IAAP) est un agent pathogène important, qui présente principalement des risques pour la santé animale et a des répercussions significatives sur la sécurité alimentaire et le commerce international.
Transmission du virus H5N1
Malgré sa capacité à persister dans les produits avicoles crus, M. Satin analyse de manière critique la possibilité de transmission du virus à la production avicole industrielle locale par le biais de viandes importées inspectées par un service vétérinaire reconnu.
Sur la base des preuves fournies par des organisations intergouvernementales (WOAH/OIE, FAO, OMS, CDC, FDA), il conclut que le risque est pratiquement nul.
Il préconise donc la révision des politiques commerciales fondées sur un principe de précaution obsolète, en proposant une nouvelle approche équilibrée qui préserve à la fois la santé animale et l’accès aux protéines avicoles essentielles pour les populations vulnérables.
Voici les points de vue de Santin :
Contrôle sanitaire
La grippe aviaire H5N1 suscite une attention croissante depuis son apparition dans les années 2000. Sa létalité chez les oiseaux et sa capacité de transmission sporadique à l’homme ont suscité une inquiétude mondiale. De plus, son impact a fortement affecté le commerce international des produits avicoles.
La transmission se fait principalement entre oiseaux vivants, soit par contact direct, soit par exposition aux sécrétions et aux excréments. Cependant, la crainte d’une contamination alimentaire a conduit à l’imposition de barrières commerciales. Dans de nombreux cas, ces mesures étaient disproportionnées, même à l’encontre de chaînes soumises à un contrôle sanitaire strict.
Résistance du H5N1 à la congélation
Des études en laboratoire montrent que le virus H5N1 peut survivre dans la viande crue congelée. Sa viabilité est maintenue pendant plus de 60 jours à -18 °C ou moins. Toutefois, cette résistance ne représente pas un risque réel d’infection.
Le danger disparaît sous des contrôles sanitaires stricts. Tout d’abord, lorsque la viande est soumise à une inspection vétérinaire avant et après l’abattage. Ensuite, lorsqu’elle est soumise à des processus industriels contrôlés. Enfin, lorsqu’elle est destinée à la consommation humaine et cuite à des températures de 74 °C ou plus. Cette condition inactive le virus avant qu’il n’atteigne le consommateur, selon les données du CDC, de la FDA et de la FAO/WOAH.
Analyse des risques pour la production industrielle locale
Dans certains cas, le risque d’introduction du virus H5N1 chez des animaux vivants par le biais de viandes importées est pratiquement nul. C’est le cas lorsque les pays utilisent des aliments industriels traités thermiquement, maintiennent les élevages isolés et interdisent les sous-produits crus dans l’alimentation animale.
De plus, le risque est réduit lorsque les déchets sont éliminés de manière contrôlée et que des inspections sanitaires de routine sont effectuées. Selon les critères épidémiologiques, le niveau de menace est proche de zéro.
L’OIE considère que le commerce de viande de volaille abattue sous contrôle sanitaire est sûr. Elle accepte même les importations en provenance de pays touchés par des foyers d’influenza aviaire, à condition que les produits ne proviennent pas du foyer. C’est pourquoi la proposition de zonage doit être évaluée de toute urgence dans les pays qui ne l’appliquent pas encore dans leurs relations commerciales.
Le principe de précaution : quand il devient une barrière commerciale
L’application stricte du principe de précaution peut être contre-productive. C’est particulièrement le cas pour les produits qui ont déjà passé l’inspection sanitaire et sont destinés à la consommation humaine. Dans ces cas, les mesures commerciales peuvent être inutiles et disproportionnées par rapport à la menace réelle.
La fermeture des marchés de viande aviaire dans ces conditions a des effets évidents. Elle ne réduit pas de manière significative le risque sanitaire. De plus, elle pénalise économiquement les pays exportateurs. Elle génère également une inflation alimentaire dans les pays importateurs et touche principalement les populations à faibles revenus, limitant leur accès à des protéines à haute valeur biologique et riches en acides aminés essentiels.
Le paradoxe des oiseaux migrateurs
Alors que l’importation de viande inspectée selon des précautions strictes est interdite, les oiseaux migrateurs continuent de circuler librement entre les frontières. Ils agissent souvent comme vecteurs asymptomatiques du virus de la grippe aviaire hautement pathogène.
Ignorer cette source naturelle de propagation et surestimer le risque lié aux aliments industriels témoigne d’une incohérence dans les politiques sanitaires internationales. C’est pourquoi ces politiques doivent être révisées de toute urgence, en tenant compte des données techniques et économiques disponibles.
Conclusion
Dans des conditions contrôlées de production, d’abattage et de transformation, les produits avicoles destinés à la consommation humaine ne présentent aucun risque sanitaire pour les élevages industriels d’autres pays. Cela est vrai à condition qu’ils ne soient pas réorientés vers l’alimentation animale ni livrés à des oiseaux vivants. Le risque de transmission du virus de l’IAAP par cette voie est pratiquement négligeable, voire techniquement nul.
Dans ce contexte, le blocage commercial fondé sur un principe de précaution exagéré n’a aucun fondement technique ni pratique. De plus, il affecte l’offre mondiale de produits avicoles, déséquilibre les marchés et nuit au bien-être nutritionnel des populations les plus vulnérables.
Un changement de paradigme réglementaire est proposé. Celui-ci doit être fondé sur le risque réel, la science et la proportionnalité. Il reconnaît que les zoonoses circulent naturellement, y compris par des moyens incontrôlables tels que la migration des oiseaux sauvages. Après tout, quel risque supplémentaire les produits avicoles représentent-ils qui ne soit déjà présent chez les oiseaux sauvages ou migrateurs ?
Références :
- Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Code sanitaire pour les animaux terrestres, 2023.
- Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2023. Gestion des risques liés à la grippe aviaire pour le commerce.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Grippe aviaire hautement pathogène (HPAI) et sécurité alimentaire, 2024.
- Organisation mondiale de la santé (OMS). Grippe aviaire : évaluation du risque de pandémie, 2024.
- Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Grippe aviaire et produits alimentaires, 2024.
- OPS/OMS. Bulletin technique sur la grippe aviaire, 2023.